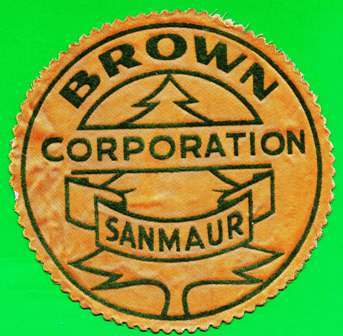Un long, long épisode de ce carnet qui se veut sanmaurien, mais…
 Une chemise qui a du kilométrage dans les coutures : c’est celle du carnetier…
Une chemise qui a du kilométrage dans les coutures : c’est celle du carnetier…
18 août 1960, vers midi.
Très exactement en face de l’embouchure de
 c’est-à-dire le Séminaire des Trois-Rivières – qui célébre justement son centenaire, qui fut l’alma mater de Maurice Le Noblet Duplessis –, le vert et l’or, finalement, le chef protégé par un béret approximativement basque. Ils sont « montés » de Saint-Tite, de Sainte-Thècle, de Louiseville et de presque tous les villages de
c’est-à-dire le Séminaire des Trois-Rivières – qui célébre justement son centenaire, qui fut l’alma mater de Maurice Le Noblet Duplessis –, le vert et l’or, finalement, le chef protégé par un béret approximativement basque. Ils sont « montés » de Saint-Tite, de Sainte-Thècle, de Louiseville et de presque tous les villages de
*****
 Les gars en kaki s’apprêtent à franchir
Les gars en kaki s’apprêtent à franchir
Deuxième à gauche, Michel Piché, à qui, un jour ou l’autre, nombre de Latuquois et de Latuquoises ont dû tendre un colis ou une enveloppe pour s’assurer de son poids et de bien l’affranchir, car il a longtemps travaillé au «vrai» bureau de poste de
Les aventureux bipèdes appartiennent au groupe Jacques-Buteux, pour la plupart, des membres du clan. Les accompagnent, pour l’occasion, deux ou trois robes noires ou apprentis curés et d’autres quidams qui ne semblent guère avoir le mollet scout, qui se sont invités à cette sortie qui s’annonce résolument forestière C’est la ballade annuelle d’été du groupe : cela s’appelle une «route»; les jeunes gens, eux, des «routiers». Pas mal de monde, mais pas tellement de véhicules motorisés pour le transport. C'est que la route, quand elle adopte la voie formatrice du scoutisme, elle se déambule à pied, beaux temps, mauvais temps, en meute : «Frappe la route, Jacques!» (air connu de Ray Charles).
 Avant l’invention du code postal…
Avant l’invention du code postal…
*****
Il fait donc très beau en ce 19 août. Et mes vacances estivales, déjà écourtées d’une semaine par les examens de l’immatriculation au baccalauréat de l’Université Laval, furent carrément gâchées par le rôle d’ASM (déjà les sigles) que je dus interpréter. Je fus en effet le troisième assistant-scoutmestre de Jean Villeneuve, le SM, scoutmestre, et, à ce titre, chef de la troupe 29e Jacques-Buteux, à l’occasion d’un affriolant festival de la mouche noire, du brûlot et du maringoin réunis, à Saint-Alexis-des-Monts, du 17 au 30 juin. Deux semaines à nourrir, à la paille fine, les voraces moustiques du coin, lesquels bossent sur des quarts de travail, trop heureux d’accueillir ces touristes forestiers.
 Adeptes plus ou moins volontaires de la secte badenpowellienne trifluvienne offrant, en guise de sacrifice aux divinités ailées des forêts du comté de Maskinongé, leurs mollets comme stations de sang libre-service. Les turbines de ces bestioles fonctionnaient au « rouge ». Quelque part, donc, dans les bois de Saint-Alexis-des-Monts, juin 1960. Photo : Pierre Cantin.
Adeptes plus ou moins volontaires de la secte badenpowellienne trifluvienne offrant, en guise de sacrifice aux divinités ailées des forêts du comté de Maskinongé, leurs mollets comme stations de sang libre-service. Les turbines de ces bestioles fonctionnaient au « rouge ». Quelque part, donc, dans les bois de Saint-Alexis-des-Monts, juin 1960. Photo : Pierre Cantin.
Décidément, au STR, il ne manquait qu’une meute de louveteaux!
À peine guéri de mes ponctions moustiquaires, je fus de nouveau obligé de me déguiser en éclaireur, de revêtir l’uniforme, de quitter le havre familial et de reprendre du service. Sur le pouce ? En autocar ? En compagnie de mes camarades latuquois Michel Piché et Jérôme Evoy? J’avoue ne plus m’en souvenir. Une photo prise à Saint-Alexis, me rappelle que Michel avait été l’un des intendants de ce camp.
Je reviens à Mattawin, donc, où le groupe de routiers s’apprête à monter à bord d’un traversier, d’un « chaland », disions-nous à Sanmaur, quelques années plus tôt, pour franchir

Dépôt Chapeau-de-Paille, le 19 août, notre autocar décapotable à une étoile pâlissante s’apprête à prendre un chemin de brousse pour déposer les kaki quelque part près de la source de la rivière aux Rats. Deuxième, à partir de la droite, Jérôme Evoy, résidant de la rue Castelneau, à
Longue entrée en matière pour greffer ces quelques photos de
 Le barrage Gouin, à
Le barrage Gouin, à
Curieusement, je n’ai que de rarissimes fragments de souvenirs de cette virée nordique, effectuée plutôt à contrecœur. Après dix mois de cohabitation intensive, à vivre en serre, baraqué dans un immense pensionnat, si prestigieux fût-il, j’aurais bien aimé profiter d’un plein été de vacances. L’été suivant, je travaillai à la division du FRÊT du Canadien National, à  Tiens, Jean Villeneuve, mon SM à Saint-Alexis, redevenu, comme moi, un routier sans grade, anonyme marcheur du clan, réfléchissant à son avenir. Il fera notaire dans la vraie vie. De mon côté, je serai, dans la vingtaine plus qu'avancée, précepteur investi des pouvoirs d'un stand-up comique dans un cégep et une université bilingue.
Tiens, Jean Villeneuve, mon SM à Saint-Alexis, redevenu, comme moi, un routier sans grade, anonyme marcheur du clan, réfléchissant à son avenir. Il fera notaire dans la vraie vie. De mon côté, je serai, dans la vingtaine plus qu'avancée, précepteur investi des pouvoirs d'un stand-up comique dans un cégep et une université bilingue.
Le 23 août, tout le monde s’est entassé à bord du Wapoose, qui mit le cap au nord, vers la réserve d’OBIDJUAN. Au verso d’une des photos du bâtiment, j’avais écrit « Le bateau du captain Skin ».
[ 
Deux de mes personnes ressources, connaisseurs en matières mauriciennes, Gaston Gravel et Richard Arseneault, ce dernier, un natif de

Le Wapoose, lors d’une escale, à l’heure du midi, le 23 août 1960, amarré à l’une des îles dudit plan d’eau. Nous avions mis près de huit heures à nous rendre à la réserve amérindienne. Une éternité pour les sardines entassées à bord du paquebot. Photo : Pierre Cantin
Question d’ajouter le classique fruit vermeil sur le sorbet de cet été perturbé, le voyage de retour de
 Un bac en panne, au 15 milles, sur la Saint-Maurice, à notre retour de
Un bac en panne, au 15 milles, sur la Saint-Maurice, à notre retour de
Photo : Pierre Cantin.
 Le matricule de notre autobus de brousse.
Le matricule de notre autobus de brousse.
________________________________________________________
NOTES ÉPARSES ... RAPAILLÉES
Sur la « notion » de clan routier, on lira avec intérêt cet article où il est question de l’influence de l’école de la route sur le grand poète Gaston Miron :
http://www.erudit.org/revue/vi/2002/v27/n2/290056ar.pdf. On y apprend, entre autres détails historiques, que
***
La route estivale de l’été 1957 du clan Jacques-Buteux fit l’objet d’une publication dont le titre, Le bâton fourchu dans les îles du grand golfe, aura sans doute plu à un autre grand poète, Pierre Perrault.  Il parut à Trois-Rivières, l’année suivante, aux Édition du Bien public de Clément Marchand. Le responsable de l'opuscule scout était Émile Descôteaux, l’aumônier du groupe, qu’on aperçoit au beau milieu du chaland en panne, sur la photo ci-haut, calme capitaine malgré la montée des eaux.
Il parut à Trois-Rivières, l’année suivante, aux Édition du Bien public de Clément Marchand. Le responsable de l'opuscule scout était Émile Descôteaux, l’aumônier du groupe, qu’on aperçoit au beau milieu du chaland en panne, sur la photo ci-haut, calme capitaine malgré la montée des eaux.
L’ouvrage avait reçu son NIHIL OBSTAT du « cens[or] deputatus » diocésain de l’époque, Hermanus [sic] Plante. Le latin connaissait encore de formidables soubresauts en ces temps héroïques où j’avais dû me farcir un apprentissage intensif – on dirait aujourd’hui « extrême » – des milliers de règles de trois grammaires : la française, la latine et la grecque. Herman Plante sera, en 1961, mon professeur d’éloquence.
***
Je n'aurai guère été un grand rhéteur et je me demande même si j'ai obtenu la note de passage de son cours. Lorsque je me présenterai, au printemps 1964, à Jules Fiola, le sympathique chef annonceur de la station radiophonique CFLM, pour une audition, il me fera remarquer, très gentiment, que je n’avais pas "la" voix recherchée. Cependant, il me proposera, sur-le-champ, dans le studio même, "le" poste de journaliste pour l’hebdomadaire L’Écho de
Incidemment, L'Écho de la Tuque et du Haut-Saint-Maurice, a paru sous ce titre, pour la première fois en 1938.
____________________________________________________
À l'été 1957, quelque part au pied d’une immense falaise de sable, dans une pinière, au bout d’un champ, à Rivière-aux-Rats, j’avais connu mon premier camp scout. Ma mère m'avait embrigadé, pour mon bien, soutenait-elle avec une certaine conviction, dans la troupe scoute qui avait sa tannière au sous-sol de l'église Saint-Zéphirin. Mon p'tit frère Robert, Bob pour la famille, n'avait pu échapper à la conscription maternelle : il avait été enrôlé dans la meute des louveteaux que commandaient de gentilles akélas. Je dois préciser ici que mon père faisait déjà partie de l'équipe qui encadrait les cadets de l'air. Justement, il y avait du kaki dans l'air... J’en ferai sûrement un épisode d’un autre carnet que je songe à créer sur
*****
De Saint-Élie-de-Caxton, qu’elle s’apprête à quitter pour emménager à Trois-Rivières, Micheline Raîche-Roy m’envoie un ouvrage récent , PIF AU VENT, une « fiction symbolique », précise son auteur, Rolland Denis, dont l’intrigue se déroule chez les Attikamekw

et qui me semble s’inscrire, par son propos et ses visées, dans la lignée « pédagogique » du récit KIKENDATCH (Anse au gros cyprès),
œuvre d’un Latuquois, Gaston Hamel, qui, en 1964, était le correspondant du quotidien québecquois Le Soleil. Un ouvrage déjà fort rare, mais dont m’a gentiment fait cadeau dame Françoise Bordeleau, érudite historienne de la ville natale du grand Félix Leclerc.
Rolland Danis. Pif au vent. Roman, Saint-Élie-de-Caxton, Les Éditions SDR, 2008, 226 pages.
Gaston Hamel. Kikendatch (Anse au Gros Cyprès).
***
Photo du rapide des Cyprès, extraite de l'essai d'Honoré Mercier,
Les forêts et les forces hydrauliques de la province de Québec, Québec,
1923, ouvrage à la typographie richissime.
 __________________________________________________________
__________________________________________________________
 Ce sigle, CFMM, désignait l'ancienne école normale Maurice L. Duplessis. Le nom du célèbre trifluvien devait disparaître de la façade l'édifice de la rue Laviolette pour faire place à une bien éphémère appellation, plutôt prétentieuse, le Centre de formation des maîtres de la Mauricie. Puis le cégep, nouvellement créé, profitant d'appuis socio-politiques puissants, s'emparera des lieux à l'automne 1968, refoulant les apprentis pédagogues et leurs maîtres chez les franciscains, devenus, en cette Révolution tranquille, une minorité invisible à l'oeil nu.
Ce sigle, CFMM, désignait l'ancienne école normale Maurice L. Duplessis. Le nom du célèbre trifluvien devait disparaître de la façade l'édifice de la rue Laviolette pour faire place à une bien éphémère appellation, plutôt prétentieuse, le Centre de formation des maîtres de la Mauricie. Puis le cégep, nouvellement créé, profitant d'appuis socio-politiques puissants, s'emparera des lieux à l'automne 1968, refoulant les apprentis pédagogues et leurs maîtres chez les franciscains, devenus, en cette Révolution tranquille, une minorité invisible à l'oeil nu.Cette fragile carte de presse m'a été très utile : grâce à sa date de "péremption" dissimulée sous mon faciès de boursouflé à la cortisone, j'ai pu rencontrer le grand Léo Ferré...