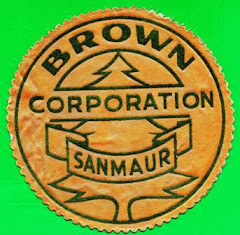Il faudrait sans doute être un cartographe accompli, un hydrographe expert, pour vraiment distinguer des changements majeurs à l’allure de la Saint-Maurice, à la hauteur de Sanmaur. Illustrée dès 1916 par un photographe du célèbre studio montréalais Wm Notman & Son, la rivière présente sensiblement la même configuration aujourd’hui, du moins me semble-t-il. Ainsi, on y perçoit toujours ces petits rapides, en aval du pont construit en 1995, lequel permet aux Attikameks (les Têtes-de-Boule de mon enfance, que certains et certaines appelaient tout simplement « kawiche », terme méprisant) d’accéder à Wemotaci, lorsqu’ils reviennent de La Tuque par la route forestière 25, entretenue ces jours-ci par Hydro-Québec (http://www.hydroquebec.com/cardc/projet/index.html), qui œuvre à l’érection de deux barrages, dont celui de Chute-Allard. Le bassin d’eau qu’il créera devrait inonder une partie de Sanmaur et de Wemotaci. Les petits rapides mentionnés devraient donc en principe disparaître !
Voici quatre photos du studio Notman, que les historiens du Musée McCord, à Montréal, datent de 1916, environ, ce qui devrait être exact, puisque le chemin de fer du Grand Tronc était déjà rendu à Sanmaur à ce moment-là. La Fraser Brace, compagnie chargée de construire le barrage Gouin, à la Loutre, tête de la Saint-Maurice, y avait déjà fait transporter, par rail, des tonnes d’équipement et de matériaux. Il y a lieu de penser que les habitations que l’on peut apercevoir sur l’une des photos, étaient celles d’employés de la Fraser Brace.
Le musée McCord possède une photo d’un pont ferroviaire, également prise en 1916, sans doute lors du même périple du photographe. Est-ce celui enjambe la Manouane ? Celui de Weymont sur la Saint-Maurice, en aval des petits rapides de Sanmaur ? Dans un prochain courriel, question d’explorer davantage les lieux de mon enfance, j’insérerai des photos récentes de ces deux ponts.
________________
À l’entrée « ATTIKAMEG », dans l’excellent GRAND DICTIONNAIRE TERMINOLOGIQUE, de l’Office québécois de la langue française, on trouve cette note.
L'Institut linguistique Atikamekw-Wasihakan du Conseil de la nation Atikamekw a rejeté au début des années 1970 le nom français Tête-de-Boule (du nom d'un poisson, cyprinidé : Pimephales promelas) pour prendre comme nom de peuple l'équivalent endogène de ce nom, celui d'Atikamekw (poisson blanc) ainsi orthographié. Cette forme est le plus souvent utilisée dans les textes administratifs en français et en anglais.
De son côté, conformément au principe de l'intégration phonétique, graphique et grammaticale des formes étrangères empruntées en français, l'Office québécois de la langue française privilégie la forme francisée Attikamek en évitant la finale kw, inusitée en français. La forme retenue, nom et adjectif, conserve la même graphie au féminin et au masculin et prend un s au pluriel. Exemples : un Attikamek, une Attikamek, les Attikameks, des travailleurs attikameks, une fête attikamek, des écoles attikameks.
La forme francisée Atticamègue (ou Attikamègue), plus rarement attestée aujourd'hui, demeure une forme historique utile mais ne peut être privilégiée puisqu'elle pourrait désigner, selon certains spécialistes, un autre groupe amérindien que celui des Attikameks.
Lecture conseillée par le carnetier (terme plus élégant que « blogueur » !) Un excellent article de Claude Gélinas sur la traite des fourrures nous permet d’en apprendre davantage sur l’histoire de ce coin du Québec : http://www.erudit.org/revue/haf/1998/v51/n3/005441ar.pdf. Les propos de son entrée en matière n’ont guère vieilli.