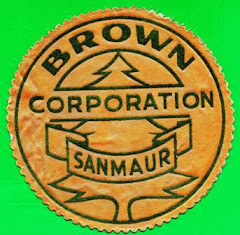A. E. ROWELL
as du gouvernail imaginaire,
marin au long récit
et grand monteur de bateaux
suivi de
Quelques activités browniennes de l’an 1921
à La Loutre et ailleurs (suite)
as du gouvernail imaginaire,
marin au long récit
et grand monteur de bateaux
suivi de
Quelques activités browniennes de l’an 1921
à La Loutre et ailleurs (suite)
[43]
 Merci, Gaston Gravel, de m’avoir autorisé à intégrer cette relique
Merci, Gaston Gravel, de m’avoir autorisé à intégrer cette reliquetélévisuelle à mon triptyque. On ne saurait trop s'acharner à confondre les sceptiques !
Tel qu’annoncé dans un épisode précédent, je reviens à ce A. E. Rowell, dit le «Captain», raconteur de grands chemins. Rien qu’à zieuter ce montage du marin d’eau douce et à en lire la légende, l’observateur avisé notera, sur le champ – et indubitablement dans son esprit – la personnalité véritable de cet original commandant maritime et son appartenance certaine à la grande confrérie des fabulateurs maritimes et des flibustiers de la fiction tordue au verbe coulant de source.
 Rowell et son méga brochet, attrapé supposément dans les Hauts mauriciens.
Rowell et son méga brochet, attrapé supposément dans les Hauts mauriciens.Un défi lancé aux collègues de la Côte-Nord sauront-ils en capturer un aussi gros ?
TBB, novembre 1921. À peine truquée, la photo…
Imaginons ce que Rowell qui excellait autant à mener les badauds en bateau qu’à réparer tout ce qu’on lui confiait, aurait pu réaliser comme agencement visuel
s’il avait eu Photoshop ou iPhoto à sa disposition !
Jerry McCarthy, à peine arrivé à La Loutre, le 9 mars 1919, note la présence du coloré Rowell. Il le présente comme le pilote d’un bateau qui vogue sur les eaux tranquilles du grand réservoir créé par le barrage dont on vient de terminer la construction. Et puis le capitaine apparaît dans The Brown Bulletin, dont l'équipe semble l'apercevoir partout...
 L’Admiral, le paquebot que pilote Rowell sur le grand plan d’eau en amont du barrage de La Loutre, en arrière-plan. TBB, juillet 1921.
L’Admiral, le paquebot que pilote Rowell sur le grand plan d’eau en amont du barrage de La Loutre, en arrière-plan. TBB, juillet 1921.Dans un long article, «Recollections» (TBB, août 1921, p. 3), Rowell raconte ses débuts aux service de la Brown Company comme forgeron dans un camp forestier de la Nouvelle-Angleterre, Parkertown. Après avoir construit un bateau à vapeur, le premier sur la Galloway, à l’été 1886, on lui confia des tâches de plus en plus délicates. Bientôt, artisan habile à réaliser tous genres de travaux, il se retrouve là où la Brown a besoin de ses talents: aux États-Unis comme au Québec. En 1886, il gagnait, précise-t-il, 25 $ par mois !
En 1921, Rowell est toujours au Québec. Il y connaît une année chargée. En mars, il vadrouille dans les Bas. D’abord à Rimouski, où, armé de deux caisses de bâtons de dynamite, il extrait d’une glace épaisse de près de quatre mètres deux bâtiments qui doivent se rendre sur la Côte-Nord, à Papinachois. Il ira là avec son comparse, un as de la mécanique, Percy Dale, à bord du Two Roses, après être passé par Amqui, en Gaspésie.
 À Québec on proposa au capitaine une petite séance de patinage au Château Frontenac. D’emblée surgit un petit problème : on fut incapable de trouver de patins à sa pointure. Le préposé à la patinoire alla jusqu’à lui suggérer d’enfiler des patins de traîneaux !
À Québec on proposa au capitaine une petite séance de patinage au Château Frontenac. D’emblée surgit un petit problème : on fut incapable de trouver de patins à sa pointure. Le préposé à la patinoire alla jusqu’à lui suggérer d’enfiler des patins de traîneaux ! Reportage de Rowell sur son passage à Rimouski et sa traversée vers Pointe-aux-Pères. Il a le sens de la narration et une bonne plume. De loin les meilleures pages du Bulletin. Coin supérieur droit, peut-être Percy Dale, l’homme à tout faire, et notre capitaine bonimenteur, à bord du Louis L., sans doute au quai de Rimouski, en mars 1921. TBB, juin 1921, p. 13.
Reportage de Rowell sur son passage à Rimouski et sa traversée vers Pointe-aux-Pères. Il a le sens de la narration et une bonne plume. De loin les meilleures pages du Bulletin. Coin supérieur droit, peut-être Percy Dale, l’homme à tout faire, et notre capitaine bonimenteur, à bord du Louis L., sans doute au quai de Rimouski, en mars 1921. TBB, juin 1921, p. 13.  Dialogue loufoque entre Dale et Rowell.
Dialogue loufoque entre Dale et Rowell.À la fin du printemps, il est de retour à La Loutre après être descendu du train du CN à Sanmaur et avoir connu des mésaventures sur la voie ferrée de la Brown entre Chaudière et le grand barrage.
Notez l'allusion au manque de liquide pour foie et estomac solides. TBB, juin 1921, p. 6.
C’est donc à La Loutre que le globe-trotteur états-unien Morris Longstreth fit connaissance avec le Captain et le propulsera dans l’histoire en le citant dans son ouvrage, conservé en effet dans les deux principales bibliothèques de ce pays qui s'étend d'une mare à l'autre.



 Extrait du récit de voyage de Longstreth, The Laurentians.
Extrait du récit de voyage de Longstreth, The Laurentians.Lieux mentionnés : Oskélanéo, Kikendatch, Obedjuan (Opitciwan),
La Bostonnais. John Carter, est le patron de la Brown à La Loutre et
Charles McKenzie est bien connu à cette époque dans les Hauts.
Longstreth fut enchanté de son séjour, surtout émerveillé par la modernité de l’endroit : électricité, chauffage, eau chaude, repas copieux, commerce agréable, surtout celui du capitaine. Il émet l'hypothèse que La Loutre est sans doute l'endroit le plus au nord du continent à être électrifié.
Il a greffé une carte plutôt rustique à son récit. Elle date de 1921 et, pourtant, même si on y trouve l'emplacement du barrage, elle n'illustre pas la nouvelle configuration marine de la tête de la Saint-Maurice provoquée par la l'édification de l'ouvrage par la Fraser Brace. L'auteur n'indique pas la source du document.
Il a greffé une carte plutôt rustique à son récit. Elle date de 1921 et, pourtant, même si on y trouve l'emplacement du barrage, elle n'illustre pas la nouvelle configuration marine de la tête de la Saint-Maurice provoquée par la l'édification de l'ouvrage par la Fraser Brace. L'auteur n'indique pas la source du document.

En août, lors d'une croisière sur le réservoir de La Loutre à bord de l’Admiral, le capitaine Rowell aurait trouvé, dans des camps de bûcherons abandonnés, une grande quantité de chaussures pour dames, de toutes les pointures, et il en aurait choisi une belle paire pour orner la proue du navire. Il a dû décrocher les souliers, car l’équipage était persuadé qu’ils étaient la cause des vents contraires que devait affronter le bateau.
1921, une année riche en activités dans les
Hauts Mauriciens (suite)
 Ah ! la belle époque des dessinateurs planchistes : en 1921, la direction du Brown Bulletin coiffe l’espace éditorial consacré aux activités québécoises de la Brown de cette magnifique en-tête, oeuvre de J. Daw, dessinateur au bureau de La Tuque. Dans le coin droit inférieur, suis-je porté à croire, il tente de donner une idée de la station de triage et récupération de billes venues des Hauts, la célèbre gappe, tout juste en amont de l’usine latuquoise.
Ah ! la belle époque des dessinateurs planchistes : en 1921, la direction du Brown Bulletin coiffe l’espace éditorial consacré aux activités québécoises de la Brown de cette magnifique en-tête, oeuvre de J. Daw, dessinateur au bureau de La Tuque. Dans le coin droit inférieur, suis-je porté à croire, il tente de donner une idée de la station de triage et récupération de billes venues des Hauts, la célèbre gappe, tout juste en amont de l’usine latuquoise.L’emplacement de La Loutre, sa situation septentrionale continuent d’attirer l’attention de l’équipe du Brown Bulletin.
Deux visites inhabituelles au dépôt de la Brown à La Loutre à l’été 1921. Outre celle de de l’écrivain Longstreth, une délégation de la Commission des eaux courantes, venue de Québec admirer la merveille de l’époque, le barrage et l’immense plan d’eau que celui-ci avait créé en 1919. À l’occasion de ce pèlerinage de ronds de cuir de la Vieille Capitale, le Bulletin publia une pleine page de photos (septembre 1921, p, 12). Je la reproduirai dans un prochain épisode.
* *
Voici quelques ajouts à la chronologie de Jerry McCarthy, des nouvelles sur les réalisations de divers employés de la compagnie et d’autres activités de la Brown à la grandeur du Québec auxquelles les gens de La Loutre, de Sanmaur et de Windigo ont pu participer.Avril
J. A. Dubé, est en poste à Papinachois. Il s’agit vraisemblablement du grand-père de Paul Tremblay. Dubé sera muté à Sanmaur pour y assumer le poste de contremaître de la cour. Puis il deviendra le maître de poste.
 L'intérêt de cette photo réside dans le fait qu’il s’y trouve un futur Sanmauresque, Reginald Viner (Vineo). De Bersimis, il passera à Windigo, puis à Sanmaur. Je me souviens du bonhomme.
L'intérêt de cette photo réside dans le fait qu’il s’y trouve un futur Sanmauresque, Reginald Viner (Vineo). De Bersimis, il passera à Windigo, puis à Sanmaur. Je me souviens du bonhomme. Photo intéressante également par la variété des styles vestimentaires de ces joyeux drilles exilés à Bersimis : on se croirait presque au bureau de la Brown à Portland, Maine, ou à celui de Québec. Existe-t-il une étude sociohistorique sur l'évolution de la tenue des travailleurs du bois ? Je suis toujours étonné de voir ces téméraires draveurs se faire aller la gaffe ...en veston chic, le chef couvert d'un superbe feutre.
 Le type de droite a la silhouette du patron de Windigo, J. Henri Pagé [1]. TBB, octobre 1921.
Le type de droite a la silhouette du patron de Windigo, J. Henri Pagé [1]. TBB, octobre 1921.Mai
 Windigo, en 1907. La Brown avait prévu l’aménagement de chantiers pour stocker du bois en
Windigo, en 1907. La Brown avait prévu l’aménagement de chantiers pour stocker du bois enprévision de l’ouverture de son usine de La Tuque. TBB, mai 1921.
Windigo sera en quelque sorte le centre «administratif» de la division forestière de la Brown en Haute-Mauricie jusqu'en janvier 1947, quand ses cols blancs seront mutés à Sanmaur.
 TBB, mai 1921.
TBB, mai 1921.Le 10, grosse tempête de neige à La Loutre.
 Le Ford sur rail de John Carter a eu des ennuis mécaniques. Cela ne se serait pas produit, souligne-t-on, s’il avait conduit un Maxwell…
Le Ford sur rail de John Carter a eu des ennuis mécaniques. Cela ne se serait pas produit, souligne-t-on, s’il avait conduit un Maxwell…Le pauvre Frank Roy, de La Loutre, doit cuisiner ses repas depuis que sa femme est partie en vacances.
Juin
Une expédition de pêche à La Loutre organisée par Norman Brown à l’intention de quelques cadres de l’usine de La Tuque, dont Tom Cleland, est annulée. Le nom de ce dernier, ainsi que celui de Simmons Brown figurent sur le contrat de joueurs de l’équipe de La Tuque de la Quebec Provincial Hockey League. Des dizaines de ces documents ont été inscrits sur le site d’enchères eBay, dont les contrats d’athlètes francophones du coin, entre autres, Oscar Dicaire.
 Merci à Richard Scarpino de m'avoir signalé l'inscription de ces contrats
Merci à Richard Scarpino de m'avoir signalé l'inscription de ces contratsmis en vente sur eBay par un antiquaire de Montréal.
Août
Le correspondant du Bulletin à La Loutre (il y a du Rowell là-dessous) prend un malin plaisir à souligner la cuisante défaite de John McCarthy aux mains d’une dame de Montréal qui l’a littéralement lessivé par un compte de 21 à 1 dans une partie de fers à cheval. Depuis, l’électricien s’entraîne intensément…
Frank Roy doit passer plusieurs heures par jour à jouer l’épouvantail à moineaux pour protéger son jardin : une solution meilleure que le fusil.
Frank Roy doit passer plusieurs heures par jour à jouer l’épouvantail à moineaux pour protéger son jardin : une solution meilleure que le fusil.
Visite du barrage de La Loutre par un groupe de fonctionnaires de la Commission des eaux courantes, créée en 1910 par le gouvernement de Lomer Gouin, dans le but d’appuyer le travail de compagnies privées productrices d'énergie hydraulique. Elle est chargée d’étudier le débit des rivières afin de le régulariser et d’analyser les phénomènes climatologiques. Elle disparaîtra en 1958.
Septembre
Deux employés de la Brown de Windigo, Joseph-Henri Pagé [»»]et un nommé Morissette, ainsi que John Carter, de La Loutre, étaient de passage au bureau de la Brown, rue Saint-Pierre, à Québec. [2]
Notes
[1] On trouvera des photos de Pagé et de son frère, en compagnie d’Eugène Corbeil, lors d’un voyage outre-mer, en 1926, dans le carnet de Micheline Roy-Raîche Roy.
http://lbiographieeugenecorbeil.blogspot.com/
[2] La compagnie y avait aussi un quai situé à l’entrée ouest du secteur du Cap Blanc, au pied de la falaise. Elle avait acheté les installations de William Lampson, un lieu appelé «Diamond Harbour» et identifié sur les cartes anciennes comme l’Anse des Mères, laquelle fut remplie. Le quai lui-même sera démoli en 1961. (Honorius Prévost, Notre-Dame-de-la-Garde, 1877-1977, Québec, La Société historique de Québec, «Cahiers d’histoire», 30, 1977.)

La numérisation des photos tirées du Brown Bulletin (TBB) a été faite à partir des exemplaires de la collection d’Hervé Tremblay.
P. S. On signale, dans la livraison de mai 1921 du Bulletin, la présence, au Chemical Mills de la Brown, à Berlin, d’un certain PETE CANTIN ! Il n’est pas de la famille du carnetier…