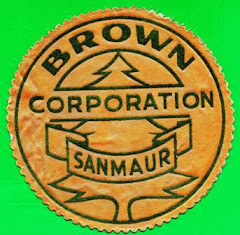Propos trinitaires tricotés serrés
ou
De quelques associations quelque peu arbitraires impliquant Maurice Richard et son frère Henri, et … un peu de bière, Chrysostome !

Mes propos de bottines m’ont valu quelques courriels de bon aloi, dont ceux de Richard Scarpino et Jean Gravel. Le premier me confie que sa mère est la sœur de … Maurice Richard, le cordonnier latuquois dont j'ai parlé dans ce carnet, et que celui-ci a un frère, prénommé … Henri, qui faisait aussi dans la semelle, mais à Lac-au-Sable. Il n’en fallait pas plus pour que je retournasse dans mon gros cahier à reliure à anneaux, où sont précieusement conservés quatre jeux complets d’icônes de valeureux hockeyeurs des années 1950, pour y puiser une rareté dont je parlerai plus bas, y en associer une autre, cocasse et plus accessible cependant (présentement on peut se l’offrir sur le site Ebay), certes, mais sur laquelle je détiens une information qui devrait peut-être frapper d’une stupeur extrême cette encyclopédie sur souliers à crampons et bottines à lame de la rue Castelneau, le susnommé Richard S. Mais je ne saurais en être tout à fait sûr : l’homme connaît son sport en yâble. Quant au second, il s’est fait sociologue pour me signaler une pratique toute discrète de la gent masculine à une certaine époque dans sa ville natale : la calage d’une p’tite bière, dans l’baquestore d'une épicerie, pendant que l'épouse fait les emplettes hebdomadaires pour sa smala.
* * *
Les mocassins bien amérindiens de Jean Gravel,
« made in Haute-Mauricie »
suivi(s) de
La grosse bière de Chrysologue
(Récits décidément bien mauriciens de Jean Gravel)
*
Gaston Gravel est, avec Hervé et Paul Tremblay, l’un des précieux collaborateurs de la première heure de mon carnet sanmauresque. Ce que j’apprécie hautement. Et voilà que son frère Jean m’expédie un fabuleux courriel, rédigé de main de conteur, d'une plume alerte, et comprenant deux parties, échos percutants à mon avant-dernier épisode. Il s'avère un fameux raconteur qui devrait lancer son propre carnet.
C’est donc avec un immense plaisir que je propose ici un
ADDENDUM EMERITUM à cet épisode de mon carnet sanmauresque déjà paru sur les cordonniers de mon enfance, oeuvre du dénommé Jean qui, comme moi, fut l’élève de demoiselle Simone Boudreau, une institution au collège Saint-Zéphirin de La Tuque dans les années 1950, décédée, il n’y a pas tellement longtemps, à un âge plus que vénérable. Jean cite aussi, parmi les noms des pédagogues qui l’ont marqué, celui de René Tremblay, le frère d’Hervé.
Voici donc la quasi totalité du long courriel que m’a envoyé Jean, que je ne saurais trop remercier. Il me permet d’en faire partager la qualité et la saveur avec d’autres Latuquois et Latuquoises de notre génération, et de celle qui la précède sans doute. Jean a une plume alerte et un sens très vif de l’anecdote.
 Jean Gravel, au défunt club Providence, quelque part dans la majestueuse
Jean Gravel, au défunt club Providence, quelque part dans la majestueuse
quiétude d’un lac de la Haute-Mauricie, à l’été 2007.
Photo fournie par le pêcheur. L’authenticité du poisson n’a pu être vérifiée par le responsable de ce carnet.
De nos jours, thanatologues et taxidermistes font des merveilles avec Photoshop.
Faut vraiment se méfier.
* * *
Bonjour Pierre,
Je suis assidûment ton carnet sur ton blogue Sanmaur, où les anecdotes rapportées à la fois m'instruisent et me rappellent de bons vieux souvenirs.
D'entrée de jeu, sur tes propos du 24 janvier dernier, tu parles de tes mocassins et de certains artéfacts fabriqués par les Attikamekw de la réserve de Wemotaci.
Et bien, je te dirai que je possède un de ces artéfacts et c'est du vrai : il s'agit d'une paire de mocassins en peau d'orignal style pantoufle « made in Haute-Mauricie », probablement fabriquée par une Attikamekw, il y a de ça au moins 50 ans.
Ces mocassins, qui d'ailleurs sont toujours en bon état, font toujours partie de mes bagages lors de mes randonnées de chasse et pêche : ce sont mes « pantoufles de bois ». Ils m'ont été donnés par monsieur Larry Brown, ancien chef de police de La Tuque. Larry était ami de mon père et chacun était membre d'un club de chasse et pêche voisin dans le secteur Windigo. Plus précisément près de l'ancien camp forestier Charlebois, le long de la grande rivière Pierreriche Nord-Ouest.
Un certain printemps, au début des années 80, alors que Larry mettait de l'ordre dans son casier, au camp principal du club, il me les avait offerts en me disant : « Ces mocassins ont de l'histoire, tu sais. » Mais sans me la raconter, il ajouta : « Ils ont été achetés au 22, il y a de ça plusieurs années. »
À la fin des années 50, avec l'ouverture de nombreux chemins forestiers par la CIP pour aller chercher leur matière première, un vaste territoire s'est ouvert au public et c'est à partir de ce moment que plusieurs groupes de la classe moyenne ont fait la demande pour l'obtention de territoires exclusifs, « Club privé, » pour pratiquer la chasse et la pêche. Les mieux nantis, eux, avaient déjà leur territoire à côté de nos portes : le Wayagamack Fish and Game Club, le club à Ti-Gus Dubois, le Club Minomaquam, dans le secteur La Croche, le Club du Lac à la Ligne, secteur Bostonnais, etc. « No Tresspassing », et malheur à qui osait empiéter sur ces territoires !
Nous autres, les porteurs d'eau, il fallait se contenter des p'tits plans d'eau des alentours dont le Creek du Pendu, le Creek du Wayagamack, mais seulement en bas de la « dam », les étangs de Fitzpatrick.
Mon père fut un des membres fondateur du Club Providence et Larry Brown, du Club Dézamy, deux territoires voisins. Le premier tracé du chemin forestier qu'il fallait emprunter pour se rendre sur ces clubs débutait sur la rive ouest de la rivière Croche, plus précisément au p'tit canot d'Alphonse Lepage, juste avant la limite sud du club des Policiers de Montréal. On empruntait ce chemin cahoteux, rocheux et tortueux pour, après plusieurs heures, arriver enfin au seul point de ravitaillement sur ce trajet, soit le Dépôt du 22, rebaptisé plus tard le Relais 22 milles.

Le relais du 22 milles. Un lieu quasi mythique dont l’existence remonte aux années 1930. Source : Internet
Pourquoi 22 ? Parce que c'était à 22 milles du village de Windigo, site du dépôt principal; plus loin, il y avait le dépôt 45. A peu près tous s'arrêtaient au 22 soit pour prendre de l'essence, un p'tit snack ou autre genre de rafraichissement alcoolisé, pris à même la caisse dans la valise du « char » ou dans la boîte du « pick up » ! Rare était ceux qui possédait un « pick up »; dans ce temps-là, ce n'était pas courant. La plupart montaient avec leur auto et, avec l'état des chemins du temps, les pannes à l'huile défoncées et les « mufflers » arrachés étaient chose courante.

Marie-Thérèse et Sylvio Desbiens. Photo gracieusement fournie par Jean Gravel.
C'est un monsieur Desbiens, Sylvio, je crois, qui, employé de la CIP, assumait la gérance de cette halte routière. On y trouvait pas grand-chose et surtout pas de boisson. « Company Policy », mais le principal y était, quoi. Toutefois il y avait une « section souvenirs », je me rappelle que, sur une des tablettes, on y trouvait quelques artéfacts, dont mocassins, mitaines avec franges, mini raquettes et canots d'écorce. Ces p'tits chefs d'œuvre étaient fabriqués par les Indiens Attikamekw du coin, dont quelques familles demeuraient tout près du dépôt, dans des camps en bois rond non écorcé; on m'a dit qu'elles faisaient partie du Clan Boivin.
Ces artéfacts étaient du vrai, pas le genre de peccadilles qu'on nous offrait dans les foires et expositions du temps, dont entre autres les fameux panaches avec des grosses plumes bleu, rouge, vert et jaune. « Il n'y a pas un seul oiseau dans nos parages qui a des plumes de ces couleurs. » C'était sans doute la mode hollywoodienne du temps !
Mais ces mocassins n'ont pas été mes premiers. Je me rappelle en avoir déjà eu une autre paire en cadeau, alors que j'étais beaucoup plus jeune, 5-6 ans.
Au début des années 50, mon oncle Vianney Allard, ingénieur forestier, travaillait pour la Cie Howard Smith […] dans le secteur Oskelaneo où, là aussi, on retrouvait plusieurs familles indiennes. Donc, afin d'avoir les bonnes dimensions pour offrir des mocassins en cadeau à ses neveux et nièces, soit moi, mon frère Gaston et mes deux sœurs, il avait demandé à ma mère de lui envoyer l'empreinte de chacun de nos pieds, tracé sur une feuille de papier. Je me vois encore pieds nus, debout sur la table de cuisine, ma mère faisant le tour de mon pied avec son crayon au plomb : « Ça chatouillait. » Ce travail complété, et les empreintes expédiées, nous recevions, après quelques semaines, pour Noël nos « pantoufles d'Indiens » et mon père, une belle paire de mitaines à frange, que Gaston a portées longtemps, mais qu'il dit avoir perdues ou s’être fait voler. Mais ce dont je me souviens le plus, c'est l'odeur caractéristique de boucane que ces petits mocassins dégageaient. Ceux-là, je ne les ai plus.
J'ouvre une petite parenthèse sur une pratique que mon oncle Vianney m'avait racontée sur l'exploitation forestière de certaines compagnies dans le secteur Oskelaneo.
Les pitounes qui y étaient coupées, étaient écorcées sur place et expédiées par wagon, car certains moulins à papier n'avaient pas de tambour écorceur (« barking drum »). Le meilleur temps pour l'écorçage débutait avec l'arrivée des mouches noires, soit fin mai début juin, et ce, jusqu'en août. C'était la période où la sève était à son maximum dans l'arbre. Avant ou passé cette période, l'écorce était beaucoup plus difficile à enlever. Donc l'abattage et l'écorçage devaient se faire pendant ce laps de temps afin d'obtenir un rendement optimal. As-tu pensé comment les pauvres gars devaient être gommés, avec les mouches en plus ? Ouf !
Voilà, c'était l'histoire de mes mocassins !
Je peux dire qu'ils ont beaucoup voyagé, mais sûrement pas autant que les souliers de Félix !

La Tuque. Les rues Tessier et Commerciale, depuis les
lieux mêmes de l’ancienne cordonnerie Ducharme, rue Scott.
Photo : Pierre Cantin, 22 mai 2006.
Pour ce qui est de Maurice Richard, le Rocket de la semelle, et de Chrysologue, le Marteleur de semelles, rien de plus vrai.
La maison des Lafleur était située pas loin de chez nous, juste sur le bord de la « track » et était sur notre trajet lorsqu'on se rendait au collège. Il y avait, dans la cour des Lafleur, un gros Saint-Bernard attaché à un bout de chaine. Il était énorme comparativement à sa niche et on se demandait bien comment il pouvait y entrer. L'atelier de Maurice, lui, était tout près de la maison des Lafleur et je me rappelle que, parmi les combustibles qu'il utilisait pour la chauffer, il prenait de vieux pneus, qu'il découpait en morceaux. Imagine la fumée au bout de la cheminée ! Au besoin, il donnait 25 cents pour un vieux « tailleur ». Je me souviens qu'avec Gaston nous lui en avions vendu un. Pour l'époque 25 cents dans nos poches, quelle somme !
 Vue de la rue Scott, vers la rue Saint-Antoine, à partir de Tessier,
Vue de la rue Scott, vers la rue Saint-Antoine, à partir de Tessier,
où le touriste trouvera l’hôtel [un hôtel, vraiment ?] Beaudet, l’un des rarissimes établissements de ce type, sinon le seul, à La Tuque. À gauche, on devine la façade de brique brune de l'Hôtel Central, démoli en 2008. Et dire que, pendant des décennies, le nombre des hôtels dudit lieu fut presque cinq ou six fois supérieur à celui des temples du culte, toutes soutanes confondues. Et je n’oserais point comparer le taux de fréquentation de chacune des deux catégories d'établissements où s'assemblaient les bonnes gens.
Photo : Pierre Cantin, 22 mai 2006.
Quant à Chrysologue, il faut ajouter à son trajet l'Épicerie La Tuque, anciennement Beaudet et Boutet, coin St-François et St-Antoine. Dans les années 60, dans le temps ou les bananes étaient à 6 cents la livre, chose que je me rappelle encore, car j'en avais tellement pesé et marqué cet été-là; mon oncle Jean-Paul Allard, alors propriétaire de l'Épicerie La Tuque, m'avait engagé comme commis pour la période des vacances. C'est là, pour la première fois, que j'ai vu de mes yeux un bonhomme caller une grosse d'une seule traite, en quelques secondes, plus rien dans la bouteille, rien qu'un peu de broue et qui était ce « Chrysologue » ? Pas le temps de s'attarder et de laisser la cordonnerie fermée trop longtemps; la clientèle était trop importante. Mais j'y pense : c'est sans doute pour ça qu'on voyait si souvent, accrochée dans les portes de certains commerces, une pancarte avec l'écriteau « DE RETOUR DANS 5 MINUTES ».

Vue de la rue Commerciale. L’immeuble en deux teintes de gris
logeait la cordonnerie Ducharme. Sur l'espace vacant, à gauche,
s'élevait le garage Dodge DeSoto d'Auguste Dubois dont
parle Jean dans son courriel. Photo : Pierre Cantin, La Tuque, 22 mai 2006.
Comme je le disais au début, tu m'as fait plonger dans mes souvenirs.
J'attends la suite de ton carnet.
Salut.
Jean.
* *
Extrait de la réponse de Jean à ma demande d’autorisation de publier sa prose dans mon carnet.
Pour ce qui est de mettre ma prose dans ton carnet, je n'y vois aucun inconvénient. Si cela peut permettre à d'autres de replonger dans leurs souvenirs comme je le fais moi en lisant ton carnet, alors, pourquoi pas.
Ah oui! J’avais oublié de te mentionner que les tavernes dans ce temps-là avaient un peu de compétition, car presque chaque épicerie (Épicerie La Tuque, Épicerie Philippe Allard, Épicerie Donat Côté, etc.)*** avait son p'tit bar clandestin dans l'arrière-boutique. On le trouvait, la plupart du temps, à l'endroit même où étaient empilées les caisses de bière. La clientèle se composait des habitués comme Chrysologue et les autres, de même que les maris de ces dames qui, pendant que ces dernières faisaient leur épicerie du vendredi soir, ces messieurs, « permission accordée », en profitaient pour en prendre une p'tite ou deux. C'était à la fois discret comme endroit et astucieux; on ne pouvait te coller l'étiquette de « coureur de taverne ».
[…]
À la prochaine,
Jean.
*** J’ai recensé pas moins de 17 épiceries dans le bottin de La Tuque Téléphone de décembre 1970.
* * * *
NOTES – APARTÉS – ANNEXES et TUTTI QUANTI
Stupéfiantes révélations sur le merveilleux monde de la collection des cartes de sport.
Puisque Jean a mentionné le nom de Maurice Richard, je me permets d’ajouter quelques commentaires sur un célèbre membre de la « branche » montréalaise de ce prestigieux patronyme. Si la carte de 1954 du Rocket m’était fort précieuse, il en était une autre, au format et à l’allure empreints de mystère, celle que l’on trouvait très, très rarement en guise de BONUS CARD, diraient aujourd’hui les revendeurs de ces artéfacts, dans certains paquets de Parkhurst de l’année 1955-1956, en plus des quatre cartes et de la palette de gomme rose que contenait chaque paquet, qui l’était tout autant. Je suis persuadé qu’il s’agit de la toute première carte-prime (expression consacrée par les linguistes radio-canadiens) de l’histoire de ces cartes de hockey modernes relancées en 1951 par la compagnie Parkhurst.
En effet, j’ai eu beau interroger les vendeurs, Internet, consulter les catalogues : personne ne semble connaître cette carte au fini glacé, en noir et blanc, sans données statistiques au verso, et ne portant qu’une seule inscription, laconique : « Henri ‘Pocket’ Richard (Forward) ». Il pose dans son uniforme du Canadien Junior. Il ne jouera pas avec son frère Maurice avant l’automne 1955 et sa carte recrue n’apparaîtra, bizarrement, que trois ans plus tard, numéro 4 du jeu 1957-1958 de Parkhurst. Même la riche (et fiable) Internet Hocket Database n’en mentionne pas l’existence…

Donc, voici, en primeur sur la Toile, la reproduction de cette VRAIE carte recrue du valeureux Henri Richard (à gauche), achetée pour un vieux 2 $ de papier à un vendeur ignorantin, au début des années 1980, et un autre exemplaire – affreusement recouverte de bouts rubans scotchés, brunis, séchés, qui m’était venu avec la collection complète de la saison Parkies 1954-1955, que m’avait vendu, à vil prix, un sympathique voisin… Je ne l’aurai eue entre les mains qu’une demi-heure : sa femme, professeur d’éducation physique, s’est pointée chez moi,
un bois 3 à la main, pour me remettre mon chèque et me faire savoir que c’était un trésor de famille auquel elle tenait ! J’ai mis quelques années à racheter les 100 cartes du jeu, à la pièce…
Un pan de mon enfance m’était revenu…
* * *
Il y aurait d’ailleurs un bel article à rédiger sur les anomalies que l’on trouve sur plusieurs cartes de hockey. Par exemple, prenant prétexte à célébrer deux mes collaborateurs assidus, Hervé et Paul Tremblay, voici l’icône TOPPS 223, de la série de 1975, qu’on présente erronément comme étant la carte recrue de
Mario Le Bleuet Tremblay. Effarouché sans doute par l’objectif de l’appareil photo de l’artiste engagé par la haute direction des Bienheureux Glorieux de la Sainte-Flanelle lors du camp d’entraînement de l’automne 1974, il a demandé à
Gord McTavish, un de ses collègues de travail des Voyageurs de la Nouvelle-Écosse, à l’époque club-école du CH, de poser pour lui.

Gord McTavish, posant en lieu et place du célèbre dossard 14 du CH. La méprise tient sans doute à la chevelure crépue et soyeuse que se partageaient à l'époque les deux individus. Admirez, en effet, la coupe de l’Almatois Tremblay sur sa carte de 1976.
Ma belle-sœur Suzanne, une Tremblay de la branche maternelle almatoise, m’a raconté qu’en voyant cette pieuse image, supposément celle de son fils, qu’une belle-sœur lui avait montrée, la pauvre mère du jeune hockeyeur se serait évanouie en apercevant ce faciès à la Hulk, tout en poussant ce cri : « Mais douce Vierge Marie, qu’ont-ils fait à mon fils ? » Le saudit plombier (les anglos utilisent le terme
grinder pour désigner ces hardis travailleurs des coins de patinoire) avait toujours fait croire à sa mère qu’il s’était fait frère mariste et missionnaire auprès des Autochtones de la Baie des Ha ! Ha !, à Gros-Mécatina, sur la Basse-Côte-Nord.
Sauf erreur, personne, depuis, n’a identifié ce type à l’allure patibulaire, et madame Tremblay croit toujours que son fils a dû subir les affres du martyre aux mains de ces payens, impression que pourrait confirmer la tuméfaction du visage de l'imposteur !
* * *

La méprise en matière de cartes sportives n’est cependant pas nouvelle. Déjà, sur cette carte de Parkhurst de 1954, celui qui patine sous le fac-similé de la signature de Paul Masnick, un blondinet aux drus cheveux, c’est l’excellent plombier des belles années du CH, Floyd Curry, plutôt dégarni sur le front, qui, à sa retraite de maraudeur dans les coins de patinoire, poursuivra sa carrière avec la Flanelle tricolore à titre de responsable des déplacements des joueurs appelés à porter le flambeau « à l’étranger »; il était chargé de réserver chambres d’hôtel et billets d’avion pour les glorieux combattants lamés.
Question de bien illustrer la justesse de mon propos et d’accentuer la vigueur de ma découverte, voici le détail de deux photos dites «Bee Hive» : à gauche, le vrai Paul Masnick, cheveux et gilet pâles, et Floyd Curry. On notera aussi la graphie fallacieuse du patronyme de Curry : « Currie ». J'en ai d'autres, de ces ignominies : à la retraite, je me propose de soumettre à l'UQAM, un projet de thèse de doctorat sur ces anomalies.
Archives de Pierre Cantin.
* * *
Et diantre, je poursuis dans la tremblayeserie : un petit montage en geste de reconnaissance à l’endroit de deux gentils collaborateurs, inébranlables et généreuses mémoires externes de mon modeste carnet.

Et puis, n’étant point chiche, voici une carte recrue, très rare, celle d’Olivier Cantin-Potvin, surnommé le « Carbo » hullois. Un fana de la Flanelle montréalaise dès qu'il eut atteint l'âge de raison. Au grand désespoir de sa mère,d'ailleurs, qui voyait en lui un futur Arthur Rubinstein. Certes, habile au clavier, il était davantage dangereux autour du but des équipes gatinoises.


* * *
P.-S. Que vient faire ce « Chrysostome» dans le décor ? C’est le patois – ponctué de deux solides accents circonflexes – que garroche, dans ses tirades, le personnage d’Émile, le compagnon d’infortune de Joseph Latour, l’anti-héros d’Un simple soldat de Marcel Dubé, puissant et émouvant classique de notre théâtre : l’exclamation m’est revenue à l’esprit par son assonance et sa graphie proches du prénom de notre petit cordonnier trottineur. Et puis la branche des Cantin, sur laquelle je demeure perché depuis plus de dix décennies, est originaire, je crois bien, de …Saint-Jean-Chrysostome !
* * *
Prochain épisode : retour à la source de la Saint-Maurice et à quelques lieux mauriciens. J'étofferai les éphémérides des années 1919, 1920 et 1929 fournies par Jerry McCarthy à l'aide d'articles et de photos tirés du
Brown Bulletin. Long processus de collecte de données, mais faut ce qui faut...

 L’AMI, première livraison, décembre 1946.
L’AMI, première livraison, décembre 1946. L’AMI, première livraison, décembre 1946.
L’AMI, première livraison, décembre 1946. L’AMI, petite feuille éditée à Windigo en 1946. Recto.
L’AMI, petite feuille éditée à Windigo en 1946. Recto. 
 Ce qui m’a forcément intéressé, ce sont les entrefilets sur Sanmaur et Windigo : deux prénoms, en particulier m’ont rappelé des souvenirs et je suis en mesure d’identifier trois types dont le nom y est mentionné et fournir le faciès de deux d’entre eux.
Ce qui m’a forcément intéressé, ce sont les entrefilets sur Sanmaur et Windigo : deux prénoms, en particulier m’ont rappelé des souvenirs et je suis en mesure d’identifier trois types dont le nom y est mentionné et fournir le faciès de deux d’entre eux. Sur cette photo de 1950, prise à Sanmaur, en face de la coukerie,
Sur cette photo de 1950, prise à Sanmaur, en face de la coukerie,  Autre photo datant de la même époque, quelque part dans les environs de Sanmaur. Louis Lemieux est à gauche, Frank Rivet, au centre,
Autre photo datant de la même époque, quelque part dans les environs de Sanmaur. Louis Lemieux est à gauche, Frank Rivet, au centre, Je n’avais pu identifier que quatre de ces Browniens sur cette photo que m'avait envoyée ma cousine Suzanne Renaud. Voilà que la mémoire vive de Sanmaur, Paul Tremblay, vient une nouvelle fois à ma rescousse et me donne cette liste : John Lacasse, l’entraîneur; Roland Dubé, gardien; Paul Bouchard, capitaine, défenseur; Wilbrod Tremblay, (d), père de Paul; Jean-Paul Laflamme (d); Roland Leclerc, ailier droit; Patrick Renaud, centre; Jean-Marc Bergeron; (c); Frank Langlois, ailier gauche; Claude Audet, (a.g.); Jos Tardif, (a.d.); Albert Boily, arbitre. Paul, qui a cette photo, me précise qu'elle a été prise le 16 mars 1949, à Montauban-les-Mines (Saint-Alban, devenu Notre-Dame-de-Montauban), dans les Hauts du comté de Portneuf, près de Lac-aux-Sables et d'Hervey-Jonction. Sanmaur avait emporté le match 8 à 4 contre l'équipe locale, les Anacon Miners.
Je n’avais pu identifier que quatre de ces Browniens sur cette photo que m'avait envoyée ma cousine Suzanne Renaud. Voilà que la mémoire vive de Sanmaur, Paul Tremblay, vient une nouvelle fois à ma rescousse et me donne cette liste : John Lacasse, l’entraîneur; Roland Dubé, gardien; Paul Bouchard, capitaine, défenseur; Wilbrod Tremblay, (d), père de Paul; Jean-Paul Laflamme (d); Roland Leclerc, ailier droit; Patrick Renaud, centre; Jean-Marc Bergeron; (c); Frank Langlois, ailier gauche; Claude Audet, (a.g.); Jos Tardif, (a.d.); Albert Boily, arbitre. Paul, qui a cette photo, me précise qu'elle a été prise le 16 mars 1949, à Montauban-les-Mines (Saint-Alban, devenu Notre-Dame-de-Montauban), dans les Hauts du comté de Portneuf, près de Lac-aux-Sables et d'Hervey-Jonction. Sanmaur avait emporté le match 8 à 4 contre l'équipe locale, les Anacon Miners.  Un beau jour, préoccupée par la possibilité que ses archives photographiques ne puissent être interprétées correctement, ma mère avait entrepris d'identifier les gens qui y figuraient. Sa griffe, dans l'encadré, rappelle ce souci.
Un beau jour, préoccupée par la possibilité que ses archives photographiques ne puissent être interprétées correctement, ma mère avait entrepris d'identifier les gens qui y figuraient. Sa griffe, dans l'encadré, rappelle ce souci.  Un beau jour, préoccupée par la possibilité que ses archives photographiques ne puissent être interprétées correctement, ma mère avait entrepris d'identifier les gens qui y figuraient. Sa griffe, dans l'encadré, rappelle ce souci.
Un beau jour, préoccupée par la possibilité que ses archives photographiques ne puissent être interprétées correctement, ma mère avait entrepris d'identifier les gens qui y figuraient. Sa griffe, dans l'encadré, rappelle ce souci. 

 La Tuque, automne 2004. Micheline Raîche-Roy et Hervé Tremblay
La Tuque, automne 2004. Micheline Raîche-Roy et Hervé Tremblay