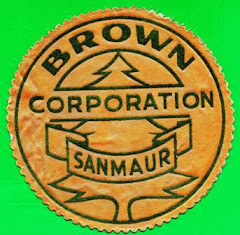Petit intermède irlandais
ou
Des Lee, passés d’Irlande en France, auraient-ils mis sur roues, en 1896, la Société des Automobiles Peugeot ?
[48]
ou
Des Lee, passés d’Irlande en France, auraient-ils mis sur roues, en 1896, la Société des Automobiles Peugeot ?
[48]
 Le réputé lion de la firme Peugeot. Il en rugissait davantage, au siècle dernier, sur les routes des provinces du Québec. Surtout des 403, rares tractions avant ces années où les étatsuniennes titanesques et musclées marquaient le macadam.
Le réputé lion de la firme Peugeot. Il en rugissait davantage, au siècle dernier, sur les routes des provinces du Québec. Surtout des 403, rares tractions avant ces années où les étatsuniennes titanesques et musclées marquaient le macadam.Cette association Lee-Peugeot m’est passée par la caboche en prenant possession, le 9 juillet dernier, à Dublin, d’une Peugeot 308 flambant neuve, à conduite à droite et boîte de vitesses à gauche, of course, une voiture de location d’Europcar Ireland, quand j’ai aperçu, sur la capot de la rutilante turlute grise, le lion argenté monté sur ses grands chevaux, emblème du fabriquant français, noble félin qui, tout à coup, me rappela celui d’un porte-clés que j’avais reçu en cadeau, et qui illustrait supposément les armoiries de la famille LEE.
 Le lion des armoiries de la famille LEE.
Le lion des armoiries de la famille LEE. Le lion de Peugeot serait-il apparenté à celui des Lee ?
Le lion de Peugeot serait-il apparenté à celui des Lee ?Photo: Pierre Cantin. Newcastle, Irlande, juillet 2009.
La ressemblance est frappante en tout cas. Mais le roi lion est-il l’emblème de ma famille maternelle ? Pas sûr, car j’ai découvert une version autre des armoiries de ce clan, sur un signet acheté au musée de l’écrivain James Joyce, à Castle Cove, en banlieue sud de Dublin.


 Au verso du carton emballage d’une épinglette des armoiries des Lee, fabriquée en Irlande, oui, pas en Chine comme les modèles de goélettes gaspésiennes, par les Heraldy-Names Manufacturers Ltd, de Ballina, dans le comté de Mayo, on peut lire que LEE est un «nom topographique» anglais.
Au verso du carton emballage d’une épinglette des armoiries des Lee, fabriquée en Irlande, oui, pas en Chine comme les modèles de goélettes gaspésiennes, par les Heraldy-Names Manufacturers Ltd, de Ballina, dans le comté de Mayo, on peut lire que LEE est un «nom topographique» anglais. L’origine (traduction de mon cru) : «quelqu’un qui habite près d’un pré ou d’un pâturage, dans la clairière d’une forêt». On ajoute qu’en Irlande on le rencontre en de nombreux endroits, surtout en Ulster, et qu’il dériverait du mot LAOIDHEACH, signifiant «poétique». Le plus grand nombre de LEE se trouveraient, de nos jours, en Amérique, sous différentes variantes du patronyme : LEA, LEIGH, LEES, LAYE, LEY, LYE, LAYMAN, LEYMAN.
LEE serait, selon Privatmark, la forme anglicisée (et sauditement raccourcie…) du gaélique O’LAOIDHIGH, qui signifie «descendant de Laoidheach» [ma traduction, toujours]. Il dériverait du mot LAOIDH, «poème» ou «chanson». Les membres du sept («clan», semble-t-il, en irlandais, merci Internet !) les plus importants auraient été des médecins, d’une génération à l’autre, au service des O’FLAHERTY. Le texte ajoute que ceux portent ce patronyme sont probablement des descendants d’immigrants anglo-irlandais. La devise des Lee : «Je l’ai accompli.»
Comme je ne connais à peu près rien en généalogie, je ne saurais être en mesure de trancher : quelles sont les véritables armoiries de ma famille maternelle ? Mystère ! Tout autant que celui de ces leprechauns , les lutins irlandais. Tout comme à Saint-Élie-de-Caxton, en Basse-Mauricie, grâce à la sagesse du sympathique Fred Pellerin, on veut les préserver des chauffards.
Comme je ne connais à peu près rien en généalogie, je ne saurais être en mesure de trancher : quelles sont les véritables armoiries de ma famille maternelle ? Mystère ! Tout autant que celui de ces leprechauns , les lutins irlandais. Tout comme à Saint-Élie-de-Caxton, en Basse-Mauricie, grâce à la sagesse du sympathique Fred Pellerin, on veut les préserver des chauffards.
Chose certaine, il y eut une concentration de LEE en Haute-Mauricie, à la fin des années 1940 et au début de la décennie suivante, et c’est là l’un des deux liens avec le présent carnet !
En effet, quatre des nombreux rejetons de mon grand-père maternel, James Robert Lee (21 avril 1889-15 décembre 1936) et de son épouse, Arthémise Bernier (18 juillet 1893-10 janvier 1929), Maizy, Donald, Juanita et Steven, auront résidé, ou plus brièvement séjourné, en Haute-Mauricie, plus soit à Chaudière, soit à Sanmaur, entre la fin de 1947 et 1955. De plus, la cousine de ma mère, Eileen Lee, m’a rappelé que sa famille, c’est-à-dire mon grand-oncle Leonard, sa femme, Jeanne Côté, et les quatre enfants, William (Bill), Eileen, Joan et Norman, étaient venus nous rendre visite à Sanmaur.
En effet, quatre des nombreux rejetons de mon grand-père maternel, James Robert Lee (21 avril 1889-15 décembre 1936) et de son épouse, Arthémise Bernier (18 juillet 1893-10 janvier 1929), Maizy, Donald, Juanita et Steven, auront résidé, ou plus brièvement séjourné, en Haute-Mauricie, plus soit à Chaudière, soit à Sanmaur, entre la fin de 1947 et 1955. De plus, la cousine de ma mère, Eileen Lee, m’a rappelé que sa famille, c’est-à-dire mon grand-oncle Leonard, sa femme, Jeanne Côté, et les quatre enfants, William (Bill), Eileen, Joan et Norman, étaient venus nous rendre visite à Sanmaur.

James Lee, mon grand-père, et sa fille Maizy, Saint-Romuald-d’Etchemin, vers 1918.
Je n’aurai par contre rencontré aucun bipède du patronyme lors de cette magnifique quinzaine passée dans la patrie de mon arrière-arrière-grand-père maternel, Thomas Lee (né en 1829) [1], qui a épousé, le 14 mars 1854, en Grande-Bretagne, une Britannique, Margaret Quinn (1828-11 novembre 1911)., et qui sera passé ensuite au Canada. Leur fils William (1855-23 février 1940) mariera Catherine Sheehy (1864-9 mars 1917) [2]. Mon grand-père sera leur quatrième enfant.



La grotte mariale de Sanmaur, œuvre du p’tit frère oblat, Conrad Auger, avec l’aide d’un flow de l’époque, Jean-Pierre Ricard, maintenant un joyeux retraité.
Photo : Léopold Lacasse, vers 1953.
 21 mai 2006 : l’ouvrage maçonné par le p’tit frère Auger tient bon. l’un des rarissimes vestiges du village. Mon frère Jesn peut en témoigner : les constructions solides, ça le connaît.
21 mai 2006 : l’ouvrage maçonné par le p’tit frère Auger tient bon. l’un des rarissimes vestiges du village. Mon frère Jesn peut en témoigner : les constructions solides, ça le connaît.
Photo : Pierre Cantin, Sanmaur; les maringouins n’étaient pas encore sortis !
Photo : Léopold Lacasse, vers 1953.
 21 mai 2006 : l’ouvrage maçonné par le p’tit frère Auger tient bon. l’un des rarissimes vestiges du village. Mon frère Jesn peut en témoigner : les constructions solides, ça le connaît.
21 mai 2006 : l’ouvrage maçonné par le p’tit frère Auger tient bon. l’un des rarissimes vestiges du village. Mon frère Jesn peut en témoigner : les constructions solides, ça le connaît.Photo : Pierre Cantin, Sanmaur; les maringouins n’étaient pas encore sortis !
Le deuxième lien avec mon carnet réside dans cette réminiscence sanmauresque, provoquée dans mon esprit, par la vision répétée de grottes mariales, repérées, ici, et là, entre Dublin et Galway, en passant par les péninsules de Killarny.
 Celle-ci, captée à Glenealy, le 10 juillet, m’a rappelé celle de Sanmaur.
Celle-ci, captée à Glenealy, le 10 juillet, m’a rappelé celle de Sanmaur. Une miniature, écrasée par une immense église de la pittoresque petite ville côtière de Dingle, découverte le 13 juillet 2009. En lisant le toponyme, je me suis rappelé le taciturne Eric Dingle, avec qui mon jeune frère Jean était ami du temps où
Une miniature, écrasée par une immense église de la pittoresque petite ville côtière de Dingle, découverte le 13 juillet 2009. En lisant le toponyme, je me suis rappelé le taciturne Eric Dingle, avec qui mon jeune frère Jean était ami du temps oùnous logions au 737, de la rue Kitchener. [3]
Et puis, une deuxième, aussi à Dingle. 
 Quelqu’un semble avoir déposé quelques fagots en guise d'offrande à cette statue, installée dans la cour d’une école, à Fanore, le long de la côte Atlantique.
Quelqu’un semble avoir déposé quelques fagots en guise d'offrande à cette statue, installée dans la cour d’une école, à Fanore, le long de la côte Atlantique.
 Une version ultra moderne, érigée en 2000, à Doolin, tout près des fascinantes falaises de Moher.
Une version ultra moderne, érigée en 2000, à Doolin, tout près des fascinantes falaises de Moher.
Photos des grottes d’Irlande : Pierre Cantin, juillet 2009.

 Quelqu’un semble avoir déposé quelques fagots en guise d'offrande à cette statue, installée dans la cour d’une école, à Fanore, le long de la côte Atlantique.
Quelqu’un semble avoir déposé quelques fagots en guise d'offrande à cette statue, installée dans la cour d’une école, à Fanore, le long de la côte Atlantique. Une version ultra moderne, érigée en 2000, à Doolin, tout près des fascinantes falaises de Moher.
Une version ultra moderne, érigée en 2000, à Doolin, tout près des fascinantes falaises de Moher. Tous ces monuments donnent à penser que, dans l’île des Saints, on ne manquait pas de loisirs, ni surtout … de pierres. Et que les Irlandais et les Québécois partagent les même passe-temps...
Photos des grottes d’Irlande : Pierre Cantin, juillet 2009.
N O T E S
[1]
Mes tantes, oncles, cousins, cousines devront probablement ajuster quelques dates de la généalogie des Lee. J’ai obtenu d’une ami, des copies numérisées de pages des registres paroissiaux de Saint-Romuald-d’Etchemin qui viennent contredire certains renseignements.[2]
Mon arrière-grand-mère mourut la journée même où naquit ma mère, Maizy Lee.[3]
 Jean Cantin et Eric Dingle. Sauf erreur, les Dingle furent parmi les premiers Irlandais à s’installer à La Tuque. En avant-plan, la silhouette de Maizy Lee, prenant la photo. Août 1961.
Jean Cantin et Eric Dingle. Sauf erreur, les Dingle furent parmi les premiers Irlandais à s’installer à La Tuque. En avant-plan, la silhouette de Maizy Lee, prenant la photo. Août 1961. Le carnetier et sa turlutte française, le long de la minuscule route 115, dit «Militaire» (Military Road), construite dans les années 1920, par les Britanniques, pour aller dénicher les rebelles irlandais retranchés dans les montagnes. Le circuit ressemble plutôt à une piste cyclable et il faut s’attendre à faire la rencontre de moutons en vadrouille.
Le carnetier et sa turlutte française, le long de la minuscule route 115, dit «Militaire» (Military Road), construite dans les années 1920, par les Britanniques, pour aller dénicher les rebelles irlandais retranchés dans les montagnes. Le circuit ressemble plutôt à une piste cyclable et il faut s’attendre à faire la rencontre de moutons en vadrouille.Photo : Jacqueline Potvin.