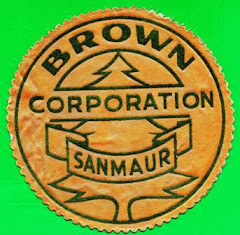MIDLIGE & RICKARD
MARCHANDS GÉNÉRAUX
MANOUANE
« John Johnstone Rickard,
merchant, of Manouan Crossing… »
MARCHANDS GÉNÉRAUX
MANOUANE
« John Johnstone Rickard,
merchant, of Manouan Crossing… »
[50]
Déjà 50 pages à mon carnet !Pour cette cinquantième page de mon carnet, je demeure dans les parages de l’embouchure de la rivière Manouane, à la hauteur de Sanmaur, et, grâce à de pertinentes et intéressantes données que me procure, une fois de plus, Paul Tremblay, je puis livrer ici quelques bribes d’histoire sur cet édifice mentionné à quelques reprises dans mes pages, un bâtiment érigé par John J. Rickard et son épouse, Eva Midlige, fille de l’aventureuse femme d’affaires Annie Midlige sans doute dès que la voie ferrée du Transcontinental eut atteint cet endroit déjà très fréquenté.
 Le magasin de Manouane, vers 1940, propriété, à l’origine de John Rickard et d’Annie Midlige. À part une affiche, à droite, sur laquelle on peut lire : «PLAYERS – CIGARETTES», rien n’indique vraiment qu’il s’agit là d’un magasin général.
Le magasin de Manouane, vers 1940, propriété, à l’origine de John Rickard et d’Annie Midlige. À part une affiche, à droite, sur laquelle on peut lire : «PLAYERS – CIGARETTES», rien n’indique vraiment qu’il s’agit là d’un magasin général.À l’avant-plan, on distingue nettement la voie ferrée du Canadien National.
Cette magnifique vue fait partie d’une photo panoramique que possède Paul Tremblay.
Il semble bien que Rickard ait été en affaires à Manouane, au moins une année avant la signature du contrat qui le liait à sa belle-mère, passé le 3 avril 1912. En effet, dans les registres de l’église anglicane St. Andrews de La Tuque, pour l’année 1911, le pasteur anglican, William L. Archer, prêtre missionnaire, a pris soin d’indiquer Manawan Crossing comme lieu de résidence du marchand , lui donnant ainsi une reconnaissance toponymique quasi officielle.



Extraits des registres de la paroisse anglicane St. Andrews, à La Tuque.
Documents aimablement fournis par Gail Aubé.
Documents aimablement fournis par Gail Aubé.
Le premier extrait signale le baptême d’Edna Margaret Rickard, fille de John Johnstone Rickard et d’Eva Midlige, le 20 août 1911. L’enfant était née le 15 juillet. L’heureux événement est cependant assombri, le 20 novembre suivant, par le décès d’un autre de leurs enfants, Evelyn Winifred, âgée à peine de 23 mois.

William Midlige, l’aîné de la famille, avait fait la manchette de quelques journaux américains en 1910, en racontant l’anecdote d’un médecin qui avait pris des loups pour des chiens.
Maxime Comtois évoque un épisode semblable dans ses mémoires (1).
* * * *
Maxime Comtois évoque un épisode semblable dans ses mémoires (1).
* * * *
L’édifice de la société MIDLIDGE & RICKARD a changé de mains à cinq reprises, avant d’être démoli, comme en témoigne cet extrait du l’«index des immeubles» pour le canton de Dessane, que m’a remis Paul Tremblay.
Les lots avoisinant la propriété initiale de Rickard. Le lot 09, à ma connaissance, est toujours la propriété d’Yvon Pelletier, un résidant de La Tuque que j’ai rencontré à Sanmaur, en novembre 2007.
C’est le 17 mai 1927 que Rickard vend son entreprise à une société concurrente, la Hudson Bay Company, qui la revend à Freddy Houle, le 12 mars 1945. Ce dernier la conserve jusqu’au 17 août 1955, quand il la cède à Adrien Arseneault, lequel semble avoir transformé les lieux en un atelier de réparations mécaniques si l’on en juge par cette photo du milieu des années 1970.
C’est le 17 mai 1927 que Rickard vend son entreprise à une société concurrente, la Hudson Bay Company, qui la revend à Freddy Houle, le 12 mars 1945. Ce dernier la conserve jusqu’au 17 août 1955, quand il la cède à Adrien Arseneault, lequel semble avoir transformé les lieux en un atelier de réparations mécaniques si l’on en juge par cette photo du milieu des années 1970.
 L’étalage de carcasses de voitures et de camionnettes du mécano
L’étalage de carcasses de voitures et de camionnettes du mécano Arsenault a plutôt gâté le paysage de Manouane.
Photo : Paul Tremblay.
Jeanne d’Arc Vignola achète la propriété le 27 août 2001. Elle est sûrement la dernière «proprietress», comme on dit communément en Irlande, où on a l’anglais assez près du français. Ainsi on y rencontre des panneaux résolument unilingue qui n’affichent pas DEAD END, mais CUL DE SAC, expression que l’on prononce «colle de sac». Ceux et celles à qui j'ai donné la traduction littérale de CUL en anglais, ont bien rigolé. Par ailleurs, dans certains patelins, le boucher s’affiche comme étant un VICTUALER.
* * * *
Des Midlige descendent en ville
En 1947, la page latuquoise de l’hebdomadaire The Shawinigan Standard consacre quelques paragraphes à des membres de la famille Midlige qui, voyageant sans doute à bord du «mixte» du Canadien National, ont séjourné à La Tuque .
Ainsi, le 14 mai, l’hebdo signale un court séjour en ville des demoiselles Edna et Eva Midlige, d’Oskelano River (Oskélanéo), et de William Midlige, accompagné de John Midlige et J. J. Richard [Rickard], leur beau-frère, de Parent. Quant aux Hilliker, de Parent, il s'agit sans nul doute des Hillier, des commerçants qui ont aussi une mercerie à La Tuque.
Ainsi, le 14 mai, l’hebdo signale un court séjour en ville des demoiselles Edna et Eva Midlige, d’Oskelano River (Oskélanéo), et de William Midlige, accompagné de John Midlige et J. J. Richard [Rickard], leur beau-frère, de Parent. Quant aux Hilliker, de Parent, il s'agit sans nul doute des Hillier, des commerçants qui ont aussi une mercerie à La Tuque.

En décembre, un entrefilet nous renseigne sur Edna «Midge» Midlige, qui suit un cours d’infirmière au Jeffrey Hale Hospital, à Québec.

* * * * *
Dans les années 1970, un virulent feu de forêt a fait des ravages dans les environs de l’embouchure de la Manouane, laissant intactes, les bagnoles du garagiste Arseneault.


Photos de Paul Tremblay, aimablement fournies par leur auteur.

Un oubli de taille
J’avais pensé inclure, dans ma galerie de grottes mariales, ce monument, photographié en mars 1960, une «marque» de mon adolescence trifluvienne.
Cette grotte avait été érigée dans ce que l’on appelait alors le «coin des finissants», partie sud-ouest de l’immense cour de récréation du Séminaire Saint-Joseph, le STR, ceinturée par les rues Laviolette, Saint-Maurice et Saint-François-Xavier. Je me demande si elle est encore là.
Elle a une certaine ressemblance avec celle de Sanmaur. Quatre élèves de Philosophie II, classe terminale du défunt cours classique, Charles [?] Laganière, Martin Fiset, Joachim Leblanc et Robert Rivard (non, je n’ai pas de mémoire: j’avais sinmplement inscrit leur nom au verso du cliché…), s’adonnent à la seule activité possible en hiver ,à l’époque, dans ce lieu d’enfermement, quand on n’aimait pas le hockey ou si on n’était pas doué pour sa pratique : la marche…
P. S. Suite à la publication de ma litanie de grottes, un ami m’a demandé, sourire en coin, si je n’avais été victime d’une poussée de fièvre papiste. Je l’ai rassuré sur mon état mental : c’est que, tout simplement, les irlandaises de pierre et de béton m’avaient rappelé la sanmauresque et la trifluvienne. Simples éléments déclencheurs de souvenirs…

[1] Geneviève Gélinas, petite-fille du médecin, a eu l’amabilité de donner l’adresse de mon carnet sanmauresque, sur la page d’accueil du nouveau site qui héberge les «Mémoires du Dr Max Comtois». Je l’en remercie.
http://drcomtois.situs.qc.ca/